Mercredi 21 Février 2018
La culture est-elle snob ?

Terrasse de café, ribambelle d’amis. La soirée se déroule à merveille. Soudain, le drame : j’avoue ne pas connaître Joe Sacco. Certains échangent quelques regards interloqués, d’autres me considèrent de la tête aux pieds comme s’ils me voyaient pour la première fois. La sentence tombe : comment est-il possible que tu ne connaisses pas le plus grand maître du reportage BD ? Puis, le coup de grâce : heureusement que je suis là pour faire ta culture. En quelques minutes, me voilà confrontée à l’immensité de mon ignorance. Exclue, pas à ma place. Une nouvelle victime du snobisme culturel.
Quand on commence à se poser des questions sur la culture, ni une, ni deux, on s’en remet à Bourdieu. En 1979, ce monsieur a écrit La Distinction. Ça ne vous dit peut-être rien, mais cet ouvrage analyse d’un point de vue sociologique les goûts et les styles de vie. En gros (et nous demandons par avance aux sociologues de pardonner l’extrême synthétisation qui va suivre), il y explique qu’il y a des pratiques culturelles « nobles », qui sont l’apanage des classes supérieures : musées, galerie, opéra. En dessous, il y a les classes moyennes, qui les imitent avec des ersatz de culture « légitime », jazz plutôt qu’opéra, photographies plutôt que toiles de maître, cinéma. Et enfin, les classes populaires qui consomment des produits culturels de grande diffusion : sport, télévision, variété. Pour lui, il y a un lien direct entre capital et capital culturel, entre goût, statut et classe sociale. Depuis, la société française a pas mal changé. La télé est devenue la star du salon, internet a bouleversé notre rapport au savoir, et les industries culturelles et médiatiques sont désormais toutes puissantes. Des évolutions conséquentes qui ont poussé d’autres chercheurs, comme Donnat ou Peterson, à revoir la théorie de la distinction de Bourdieu. Ainsi est apparue l’idée que les classes supérieures ne se distingueraient plus en allant à l’opéra ou voir des pièces d’avant-garde, mais en allant piocher dans tous les répertoires : en s’encanaillant du côté des cultures populaires. Plus le panel culturel est large, au mieux c’est. À ce stade là, on a presque envie de se réjouir : toutes les cultures se mélangent et s’échangent sans distinction de condition sociale, dans l’amour et la fraternité. Sauf que les pratiques dites « savantes » restent l’apanage des plus favorisés (il n’y a qu’à voir la fréquentation des musées), et que les emprunts à la culture populaire sont souvent justifiés.
Avez-vous déjà vu un musicien défendre Booba à grand renfort de références aux monstres sacrés du jazz, ou un intellectuel expliquer son amour du ballon rond en replaçant les matchs dans leur contexte géopolitique ? C’est cocasse. La distinction s’immisce désormais dans toutes les disciplines : le bon rap et le mauvais rap, les bonnes séries et les mauvaises séries, bref, les productions qui ont une valeur artistique, contre celles purement commerciales. Cette distinction se manifeste d’ailleurs dès le plus jeune âge. Tomas Legon a ainsi écrit une thèse sur « La recherche du plaisir culturel. La construction des avis a priori en musique et cinéma chez le public lycéen », pour laquelle il a réalisé une série d’entretiens. Il y a d’un côté ceux qui, comme Loïc, dont le père a un BEP, se fient à Skyrock pour sélectionner leurs morceaux de rap préférés : « Y a que celles qui passent à la radio que j’écoute. L’reste d’l’album j’écoute pas. », et en opposition, ceux que cette démarche « dégoute », comme David, fils de kiné, qui fait des recherches pour sélectionner les morceaux : « Si j’vois qu’ça fait beaucoup de bruit (...) , moi, j’prends ça un peu pour du commercial (...), j’sais qu’c’est bidon. ».
On se retrouve donc avec une quantité astronomique de produits culturels disponibles, des prédispositions en fonction de notre appartenance sociale, et un snobisme qui s’applique dans absolument toutes les disciplines. Avec tout ça, on a vite fait de se sentir exclu. Il n’est pas étonnant qu’un peu plus d’un quart des français soient à l’écart de la culture, comme l’a révélé un sondage réalisé par Valeurs Cultures et l’Ifop en 2017. Cet éloignement n’est pas seulement dû à des causes matérielles, financières ou pratiques, mais aussi à un manque d’envie assumé. Ainsi, sur les 1 500 personnes interrogées, 48% ne lisent pas, 26 % ne vont pas voir d’exposition et 34 % ne vont pas au théâtre, simplement par désintérêt. Le niveau de diplôme et l’environnement social étant les variables les plus discriminantes dans l’appréciation de l’importance de la culture, bien plus que le sexe, l’âge ou la taille de la commune de résidence. Comment, alors, donner l’envie, l’envie d’avoir envie ? (RIP Johnny).
Épater la galerie (d’art)
Pour Lydie Marchi, historienne de l’art qui travaille avec le centre social de la cité de la Castellane dans les quartiers Nord de Marseille, il faut du temps, et de la bienveillance. « Quand je suis arrivée à la cité, on me regardait un peu bizarrement, surtout les jeunes ! Et puis on a commencé à parler de tout, et ils ont très vite baissé leur garde ». Pour elle, toutes les actions peuvent mener à l’ouverture sur la culture : visiter un musée, décider pendant 10 jours de passer 10 minutes à lire Shakespeare, travailler avec les structures culturelles de la ville ou inviter un artiste à venir en résidence dans la cité : « je n’ai qu’une seule exigence, explique-t-elle, c’est de ne rien s’interdire. Je me suis très vite rendue compte que je pouvais aller vers des choses très difficiles, et notamment vers l’art contemporain.» L’art contemporain ?! Dans ces galeries où des individus étrangement vêtus s’extasient devant une motte de terre, utilisant des mots comme « disruptif », « trans-avant-garde » ou « anamorphose » ? Serait-il finalement accessible à un public non-averti ? « Oui, assure Lydie, parce qu’il n’y a pas de limite. L’artiste est libre… un peu comme un chanteur de rap ! Il fait ce qu’il veut, même si parfois c’est n’importe quoi. ». Puisque ce n’est pas le contenu qui rebute les visiteurs, voilà qu’on s’interroge sur les raisons pour lesquelles les galeries manquent de diversité. « Le principal frein, c’est l’éducation, tranche-t-elle. Que ce soit à l’école où l’exclusion culturelle n’est pas la priorité, ou à la maison. L’éloignement des centres culturels est aussi à prendre en compte : quand tu mets une heure pour aller dans un musée ou une salle de spectacle, ça refroidit. Enfin, il y a la vraie barrière du « c’est pas pour moi ».
Le contexte social et familial est donc, sans surprise, un facteur déterminant pour prendre l’habitude de fréquenter des lieux culturels et pour s’approprier l’espace public. Si les enfants et les jeunes sont facilement enclins à partir à l’aventure, pour les adultes qui ont intériorisé pas mal de barrières, c’est une autre paire de manches. « Pendant 4 mois, 20 femmes migrantes ont participé à un projet participatif autour d’une expo du Mucem, se souvient Lydie. Certaines d’entre elles n’étaient pas revenues sur le Vieux-Port depuis qu’elles étaient arrivées à Marseille il y a plusieurs années. Elles ont travaillé en atelier, se sont rendues plusieurs fois au musée, participé à des réunions. Au moment de l’exposition, nous avons amené 50 personnes de la cité, hommes, femmes, enfants. Elles ont eu une immense fierté, le jour J, de montrer à leurs enfants que le Mucem, c’était chez elles. Elles connaissaient tout par cœur, c’était une journée incroyable ».
Tous les goûts sont dans la culture
Entre l’analyse de Bourdieu et le récit de Lydie, on se dit que toute cette histoire d’exclusion culturelle est complexe, et en même temps, ne tient pas à grand chose. Inciter les jeunes à lire ? Il lui a « suffi » d’ouvrir une petite bibliothèque pour qu’ils s’en emparent et ramènent leurs frères et sœurs. Les initier à la photo ? Elle a fait venir le photographe Teddy Seguin pour les faire travailler sur l’image de la cité, ce qui leur a valu plusieurs expositions, 8 pages dans Libération et la création du magazine Castemag. Et elle va sans doute en faire une nouvelle fois la démonstration pendant MP2018, pour qui elle organise plusieurs actions avec des artistes au sein de la cité : un worskhop, une récolte de chansons auprès des habitants pour créer un opéra du quartier, et bien sûr, tout un plan de médiation autour des grands événements.
Et vous, et nous ? Lydie ne sera pas là pour nous prendre par le bras et nous guider à travers ce merveilleux paysage culturel. Il ne tient qu’à nous d’aller, comme dirait Joe Dassin, nous balader sur l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnu. Acceptons de ne pas comprendre une expo ou de ne pas aimer un artiste. Entrons dans les librairies et les galeries, et n’ayons pas peur de nous heurter à un interlocuteur snob. Bref, n’ayons pas peur de nous sentir bête ou inculte. Ce que Lydie nous prouve, c’est que ce n’est pas la culture qui est snob, mais juste certaines personnes. Les élites du savoir, les arrogants de la culture, les prétentieux des galeries d’art. Tous ceux qui affirment au lieu d’expliquer, qui méprisent au lieu de rendre intelligible. Alors la prochaine fois que l’envie vous chatouille de dire « Quoi ?! Tu ne connais pas ÇA ?! », prenez donc deux petites secondes pour descendre de vos grands chevaux et demandez-vous plutôt comment vous pourriez devenir, à votre tour, un petit passeur de culture.
On s’y met ! : art contemporain, le guide
Élisabeth Couturier est passionnée d’art contemporain. Convaincue qu’il s’adresse à tous, elle a imaginé un guide pratique à destination des non-initiés. Elle y explique les grands concepts fondateurs de la discipline, en présentant les dates clés et les artistes phares, et propose aux lecteurs de se plonger dans l’art contemporain à partir de leur thématique de prédilection : arts du monde, nouvelles technologies, féminisme, érotisme, graffiti... Une initiation toute en douceur, qui vous décidera peut-être à pousser les portes des galeries.

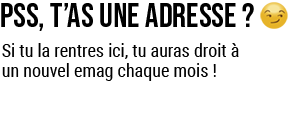















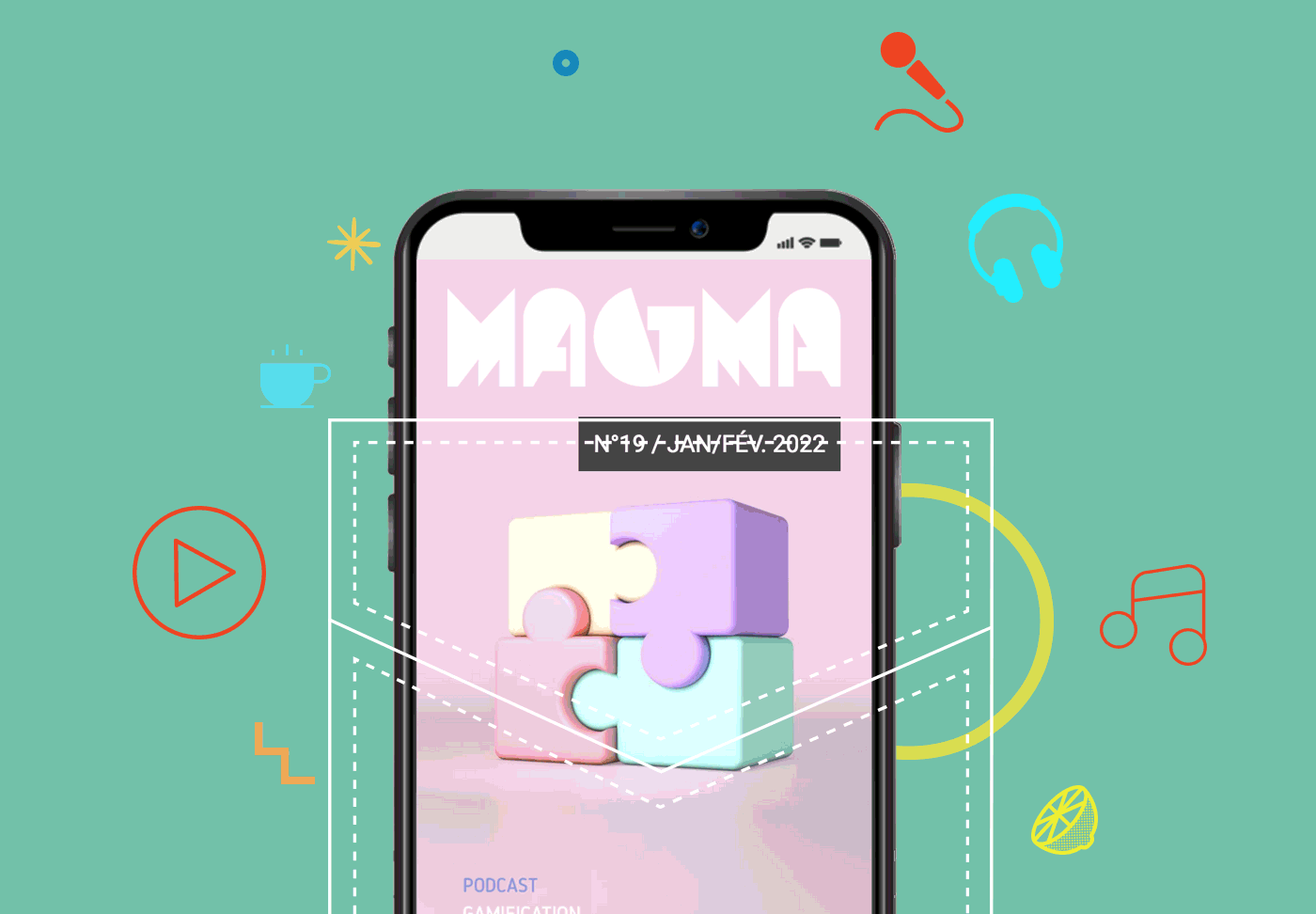










Partagez cet article